Parcours Académique
Baccalauréat en histoire de l’art, Université de Montréal, 1968-1971
En 1968, je me suis inscrite au programme d’histoire de l’art de l’Université de Montréal. L’enseignement initiait les étudiantes et les étudiants à la méthode du connaisseurship basée sur l’identification des traits formels des œuvres afin de les classer dans une catégorie stylistique et de les attribuer à leurs auteurs. Étaient aussi enseignées les conceptions des auteurs canon de la discipline telles que l’analyse iconographique et iconologique des œuvres de Panofsky, l’approche cyclique de leur histoire formelle élaborée par Wölfflin ainsi que l’approche sociologique de Pierre Francastel. Il m’est apparu que sa conception de l’histoire de l’art offrait une approche différente de celles des historiens d’art qui l’avaient précédé. J’ai découvert une interprétation des œuvres fondée sur leur contextualisation culturelle appliquée à l’étude de ruptures artistiques représentées par les œuvres de la Renaissance italienne et de la modernité. J’ai retenu que Francastel a démontré que ces œuvres avaient contribué à l’émergence de nouvelles visions du monde par la création de représentations visuelles du réel. La découverte de cette conception de l’histoire de l’art a été déterminante pour moi, sans que pour autant que mon cheminement de chercheure ait suivi la voie tracée par Francastel. Cependant, elle m’a incitée à étudier les modes d’insertion des œuvres dans leur contexte socioculturel.
Maîtrise en histoire de l’art, Université de Paris-Nanterre, 1971-1973
En 1971, je me suis inscrite au programme de maîtrise offert par le département d’histoire de l’art de l’Université de Paris-Nanterre. Mon mémoire a été dirigé par Marc LeBot dont les travaux de recherche et l’enseignement s’inscrivaient dans la continuité de la pensée sociologique de Pierre Francastel. Ouvert à l’art contemporain, Marc LeBot avait accepté que mon mémoire porte sur un moment alors actuel de l’art québécois, l’année 1968, période de contestation sociale qui s’était manifestée dans le milieu de l’art par les remises en question des notions artistiques propres aux courants antérieurs du modernisme. Le choix de ce sujet a été influencé par les cours sur l’art québécois de François-Marc Gagnon que j’avais suivis à l’Université de Montréal. J’avais apprécié que son enseignement se démarquait du point de vue de professeurs d’origine européenne qui considéraient que l’histoire de l’art du Québec était trop récente pour constituer un sujet d’enseignement et de recherche valable. Commentaire critique que les études culturelles qualifient d’attitude coloniale.
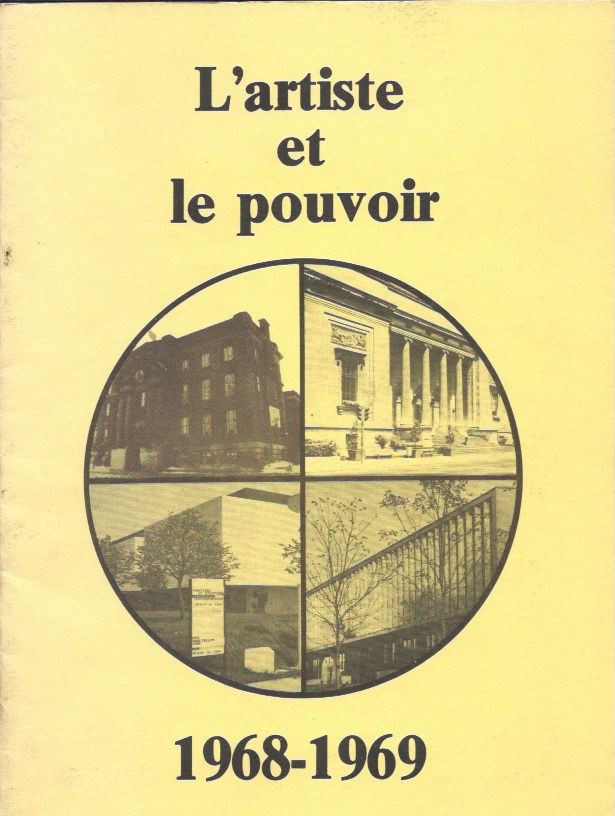
Mon mémoire de maîtrise donna lieu à une publication intitulée L’artiste et le pouvoir 1968-1969 (1) rédigé avec mon amie Suzanne Lemerise que j’avais connue durant mes études de 1er cycle à l’Université de Montréal, et qui s’était aussi inscrite au département d’histoire de l’art de l’Université Paris-Nanterre. Marc Lebot nous avait proposé de partager le corpus de l’analyse synchronique de la vie artistique à Montréal en 1968 afin de comprendre les dynamiques structurant les activités des différentes instances de son champ artistique, leur inscription dans le contexte social, ainsi que les prises de position des artistes à l’égard de ces instances. Nous étions au début des années 1970, l’analyse des institutions culturelles et artistiques était dominée par le concept de champ artistique défini par Pierre Bourdieu. Ce concept axé sur la mise en lumière des luttes entre les acteurs du champ artistique pour la conquête de la légitimation culturelle des œuvres était une notion incontournable. Notre analyse du contexte de la vie artistique au Québec, dans les années 1968-1969, s’est appuyée sur ce concept du champ artistique. Les propos de L’artiste et le pouvoir 1968-1969 affichent une portée polémique. Nous avions pris le parti de ceux et celles qui, en réclamant une plus grande insertion sociale des pratiques artistiques, remettaient en question les normes et les critères définissant les courants du modernisme. Nous avons identifié des pratiques artistiques qui réalisaient cette nouvelle relation avec l’espace public, tels les happenings, l’art de l’environnement sollicitant la participation du public, les œuvres éphémères dans l’espace urbain, les performances héritées du théâtre de guérilla culturelle. Le contexte socioculturel de ces œuvres était celui des rassemblements d’artistes qui aspiraient à une reconnaissance accrue de leur rôle social. Ces revendications rejoignaient celles des étudiants qui, à l’automne 1968, occupaient l’École des Beaux-Arts de Montréal et considéraient cette institution comme une tour d’ivoire existant en marge des activités de la société actuelle. Dans les quotidiens, des critiques d’art avaient fait écho à ces discussions. L’enseignement donné à l’École des Beaux-Arts avait également été critiqué par les membres de la Commission de l’enseignement des arts présidée par le sociologue Marcel Rioux (2). Ils ont proposé un élargissement de l’insertion sociale des pratiques artistiques dans les domaines de l’environnement et du design. Notre étude a donc mis en lumière l’effervescence et la synchronisation de ces débats sur la fonction sociale de l’art qui annonçaient un changement de paradigme.
Références
- Francine Couture et Suzanne Lemerise, L’artiste et le pouvoir : 1968-1969. Montréal, Groupe de recherche en administration de l’art, UQAM, 1975.
- Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, 3 volumes, l’Éditeur officiel du Québec, 1969, vol 1. 298 p. vol. 2, 382 p., vol.3, 203
- Raymonde Moulin, L’artiste, l’institution et le marché, Paris, Flammarion, 1992.
- Francine Couture, Le marché des chromos à Montréal et dans la région métropolitaine, sous la direction de Raymonde Moulin, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, octobre 1981. Raymonde Moulin a fait un résumé de ma thèse dans son livre L’artiste, l’institution et le marché, Flammarion, Paris, 1992, p. 35-36.
- Pierre Bourdieu « Le marché des biens symboliques », L’Année sociologique, 1971, p. 49-126.
- Howard Becker Art Worlds, Los Angeles, London, University of California Press, Berkeley, 1982.